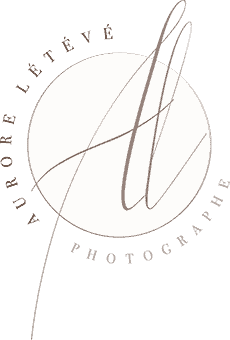
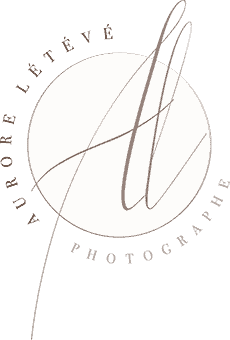
Photographe de grossesse à Lyon
Devenir mère après un long parcours peut sembler irréel. La grossesse est une étape précieuse, façonnée par un parcours personnel. Ce sont des émotions profondes et l’attente d’un moment que l’on veut graver pour toujours.
Vous êtes enceinte, et vous savez combien cette période est importante. Tant d’années à espérer, tant de doutes et d’attentes avant que ce rêve ne devienne concret.
Lorsqu’elle arrive après plusieurs années d’attente, de questions et parfois de doutes, votre grossesse est précieuse. Cette période mérite d’être célébrée et conservée à travers des photos pleines de sens.

En tant que photographe, je suis attentive à ces histoires particulières et aux émotions qu’elles portent. Je sais ce que représente ce moment pour une femme qui a longtemps attendu son bébé. Chaque femme qui choisit de réaliser une séance photo de grossesse a un vécu unique. Et mon rôle est de lui offrir des images qui en témoignent. Il s’agit de vous permettre de faire durer votre grossesse. Garder une trace sensible de ce que vous avez traversé pour en arriver là.
Photographe spécialisée dans la maternité, je vous accompagne durant cette période singulière. Photographe professionnelle à Lyon, vous serez guidé pour une séance photo pensée avec soin pour raconter votre histoire.
Attentive aux parcours singuliers, je suis là pour vous offrir une expérience de qualité et à la hauteur de ce moment tant espéré. Chaque femme mérite une séance photo qui mette en avant son histoire unique, son parcours, et l’émotion qui l’accompagne. Chaque grossesse est différente, et chaque shooting doit refléter cette singularité. Ici, vous n’êtes pas une grossesse parmi d’autres, vous êtes une femme avec son histoire, sa force, et ses espoirs.
Se voir enceinte à travers des photos permet de réaliser pleinement cette transformation. Vous pouvez vous projeter plus loin dans votre maternité et l’accueillir avec sérénité.
Une séance photo pour réaliser que vous êtes enceinte. Lorsqu’une femme tombe enceinte après un parcours long ou une PMA, cela peut sembler difficile à réaliser pleinement. Il faut parfois du temps pour prendre conscience que cette période tant désirée est enfin arrivée.
Photographe de grossesse à Lyon, je suis à vos cotés pour accompagner cette prise de conscience. Cette séance photo de grossesse douce et professionnelle vous aide à vous projeter concrètement vers l’arrivée de votre bébé. S’accorder une séance photos, c’est prendre un instant pour se reconnecter avec l’histoire de votre futur bébé.
Au studio, l’atmosphère est douce et chaleureuse, aux tons blancs et lumineux. Cela permet à chaque femme enceinte de se sentir rassurée et mise en confiance. Vos émotions et votre bonheur deviennent ainsi visibles, palpables. Chaque détail compte pour que vos photos de grossesse reflètent pleinement l’intensité de votre expérience.
Vous pouvez envisager une séance photo de grossesse uniquement. Vous pouvez aussi la combiner avec une séance photo de nouveau-né après la naissance de votre bébé. Votre grossesse et la naissance de votre bébé méritent d’être préservées à travers des images fortes et sensibles.
Ces souvenirs enrichissent le patrimoine de votre famille et traverseront les générations. Créer un album de photos de grossesse et de naissance permet de conserver précieusement ces souvenirs et de les partager avec votre enfant lorsqu’il grandira.

Être aux petits soins pour vous et votre bébé
La maternité ne transforme pas seulement une femme : elle ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire d’une famille.
Je vous propose une séance photo qui rassemble, dans un cadre apaisant et structuré, les personnes qui vous sont chères.
Un moment à part, pour se recentrer, ressentir pleinement cette étape, et se projeter vers l’arrivée de votre bébé.
Certaines futures mamans me confient qu’elles ont mis du temps à réaliser ce qui leur arrivait.
Quand la grossesse est le fruit d’un long parcours, il faut parfois un espace où l’on puisse poser les émotions, respirer, et accueillir enfin cette nouvelle réalité.
Les séances que je propose ont été pensées pour ça. Pour vous aider à vous reconnecter à votre histoire, à votre force, à ce que vous êtes en train de devenir.
Chaque image devient alors un repère intime. Le témoin sensible de cette transition vers la maternité.
Ces souvenirs prennent vie dans un album conçu sur mesure, fabriqué à la main, pensé pour traverser les années et transmettre votre histoire à votre enfant.
La séance peut se vivre en studio, dans une ambiance lumineuse et feutrée, ou en extérieur, dans des lieux préservés aux alentours de Lyon.
Les saisons offrent chacune leur poésie : la lumière d’un soir d’été, les feuillages dorés de l’automne ou la douceur discrète de l’hiver.
Ensemble, nous choisirons l’environnement dans lequel vous vous sentirez à votre place.


Pensé et conçu pour la photographie de grossesse et de naissance, le studio photo à lyon vous accueille dans une ambiance chaleureuse et intimiste. Je travaille uniquement en lumière naturelle, pour des photos douces et poétiques. Un shooting en studio permet de créer des images sobres et parfaitement adaptées à votre histoire.
Vous souhaitez avoir des souvenirs plutôt intimes de votre grossesse, le studio est fait pour vous. Un shooting en studio permet de capturer avec douceur et authenticité chaque courbe de votre ventre arrondi. Il est doté d’une garde-robe dédiée avec de longues tenues de grossesse. Vous pouvez également profiter des accessoires à assortir à votre lingerie (tuniques en dentelles, déshabillés de soie, etc …).
Vous aimez la nature et ses couleurs ainsi que sa végétation changeante au cours de l’année ? Alors pourquoi ne pas réaliser votre séance photo en extérieur dans les environs de Lyon ? Je saurai vous proposer différents lieux déjà expérimentés lors de précédents shootings.
Les couleurs chaudes de l’automne. La douce lumière tamisée de l’hiver. La chaleur d’une fin de journée d’été ou encore les petites fleurs du printemps. Ce sont autant de bonnes raisons de songer à créer de superbes images en extérieur.
En tant que photographe attentive aux détails, j’ai imaginé une garde-robe pensée exclusivement pour vos séances de grossesse. Elle se compose de vêtements aux tons doux, sélectionnés pour leur qualité, leur élégance et leur raffinement. Chaque pièce a été choisie avec soin pour accompagner vos formes avec justesse, tout en respectant votre style. Ces vêtements mettront délicatement en valeur votre ventre rond, tout en reflétant votre personnalité et votre style.
Lors de la première étape de préparation de votre shooting de grossesse, je vous guide dans le choix des tenues et la création complète de votre stylisme (Papa, Maman et vos ainés si vous avez déjà des enfants). Le dressing du studio contient plus de 120 tenues. Vous y retrouverez des matières nobles comme de la dentelle, de la mousseline, etc. Pour vos aînés jusqu’à 4 ans, le studio a créé une large garde-robe de petites tenues dans des tons neutre, avec beaucoup de blanc. Vous vous demandez comment choisir la tenue idéale pour votre séance ? Découvrez tous mes conseils pour bien sélectionner votre tenue de séance photo grossesse.
Cette garde-robe est régulièrement enrichie pour vous offrir des pièces variées, intemporelles et raffinées. Parce que chaque future maman mérite de se sentir parfaitement elle-même durant cette séance si spéciale.

La grossesse est un de ces moments où l’on pense surtout à son bébé. Le jour de la séance, celle-ci commencera par votre mise en beauté(maquillage et coiffure) réalisée entièrement par mes soins. Il s’agit pour vous d’être naturelle et de mettre en avant vos atouts. Je vous propose un soin réconfortant et un maquillage très léger pour atténuer les signes de fatigue par exemple.
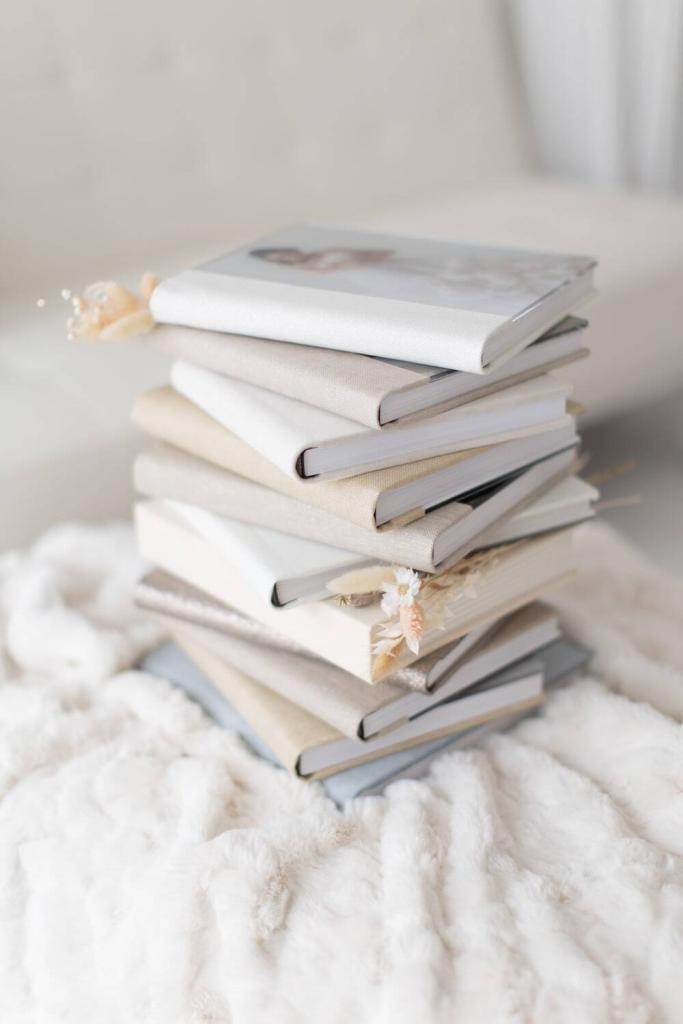
Le travail d’un photographe ne se limite pas à prendre des photos. Il s’agit de créer un cadre rassurant, de guider avec douceur pour que chaque sujet se sente à l’aise, et d’être attentif à chaque détail. C’est ce qui fait toute la différence entre une simple image et une photo qui prend tout son sens.
La lumière naturelle de mon studio permet d’apporter une atmosphère douce et intemporelle à vos images. Photographe depuis plus de dix ans, je privilégie une approche naturelle, en accord avec l’histoire que vous souhaitez raconter à travers vos portraits.
Chaque séance est une rencontre entre une histoire, une émotion et mon regard de photographe. Que ce soit en studio ou en extérieur à Lyon, chaque shooting de grossesse est pensé pour raconter votre histoire avec élégance et sincérité. Comme dans un mariage, où chaque élément est soigneusement choisi pour créer une harmonie. L’approche que je propose repose sur l’attention portée aux détails et à la justesse des images.
Loin des tendances éphémères, mon travail s’inscrit dans une démarche intemporelle, où chaque photo aura du sens aujourd’hui comme dans plusieurs années.
Pour en savoir plus sur mon parcours et ma philosophie de travail, découvrez aussi ma page photographe professionnel à Lyon.
Votre grossesse est une période intense, faite d’émotions et de transformations profondes. Vous méritez des photos professionnelles qui respectent votre personnalité et votre histoire. Toutes les images que je vous présente lors de votre séance de découverte au studio sont soigneusement retouchées. Vous avez l’assurance d’une qualité irréprochable à chaque cliché.
Mon approche diffère des photographes qui proposent simplement une galerie en ligne. Je privilégie une présentation personnalisée au studio. Vous pourrez ainsi prendre le temps d’apprécier pleinement vos images, et de choisir les supports qui accueilleront ces précieux souvenirs.


Contrairement aux solutions impersonnelles où les photos sont simplement déposées dans une galerie en ligne, je tiens à proposer une approche plus immersive. La découverte de vos images se fait au studio photo à Lyon. C’est un rendez-vous dédié où vous pourrez revivre les moments clé de votre séance. En ma qualité que photographe, j’attache une grande importance à cette étape. Elle permet de revivre pleinement l’expérience et de choisir avec soin les supports qui conserveront vos souvenirs. Voir ses photos imprimées sur un support physique permet de donner encore plus de valeur à ces souvenirs de grossesse.
Ces images prendront vie dans un album luxueux conçu sur mesure. Chaque support d’impression est sélectionné pour garantir une qualité durable. Il résistera au temps et pourra être transmis à travers les générations au sein de votre famille. Avoir un album de grossesse, c’est offrir à son enfant un témoignage visuel de son histoire dès ses premiers instants.
Chaque femme enceinte mérite mieux qu’une galerie numérique impersonnelle. Mon travail de photographe professionnelle consiste à créer des photos qui racontent votre histoire, en intégrant votre vécu, vos émotions et tout ce qui rend votre grossesse unique.
Ensemble, transformons cette période précieuse de votre vie en un héritage tangible et plein de sens.
Les femmes et les familles qui me confient leur séance photo de grossesse soulignent régulièrement la qualité des images retouchées ainsi que la précision de mon approche professionnelle. Leurs avis témoignent du soin que j’apporte à chaque étape du processus : préparation, prise de vue, retouche et présentation au studio. Faire appel à une photographe professionnelle spécialisée en grossesse, c’est vous assurer que chaque moment vécu au cours de cette période unique sera traité avec délicatesse, précision et attention aux moindres détails. Chaque séance est l’occasion de créer des souvenirs intemporels pour vous et votre famille.
Le studio ne propose qu’un nombre restreint de shootings photo de grossesse chaque mois. Je vous conseille de réserver votre séance au début de votre second trimestre de grossesse.
Après la grossesse, certaines mamans choisissent aussi de prolonger cette aventure photographique avec une séance photo maman & bébé.
Mon studio, situé à Fontaines-sur-Saône, est facilement accessible depuis plusieurs communes de l’ouest lyonnais et des Monts d’Or. J’y accueille régulièrement des futures mamans venant de Caluire, Caluire-et-Cuire, Écully, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or ou Dardilly.
Si vous habitez l’une de ces villes, voici quelques repères pour mieux comprendre ce que je peux vous proposer.
Vous habitez Caluire-et-Cuire ou ses environs ?
Découvrez ma page dédiée aux séances grossesse à Caluire, pensées pour les femmes ayant vécu un parcours singulier vers la maternité.
Vous habitez Écully et vous êtes à la recherche d’une photographe capable de comprendre ce que représente cette grossesse pour vous. Mon studio, situé à proximité, vous accueille dans un environnement calme et lumineux, conçu pour vous offrir une véritable parenthèse. Dès nos premiers échanges, je prends le temps de vous écouter, de comprendre votre histoire, et d’adapter chaque étape à vos besoins. Ici, rien n’est laissé au hasard : l’accompagnement est structuré, respectueux et profondément humain.
Vous vivez à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, et cette grossesse, vous l’avez attendue, espérée, parfois traversée avec beaucoup d’émotions. Mon studio, à quelques kilomètres de chez vous, est un lieu pensé pour accueillir ces moments avec douceur et précision. Je vous accompagne avant, pendant et après la séance, avec une attention constante à votre rythme, vos émotions, vos envies. Chaque détail est soigné, pour que cette séance reflète ce que vous avez traversé — et ce que vous êtes en train de vivre.
Vous attendez un bébé à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, et vous souhaitez garder une trace forte de cette période unique. Dans mon studio, à deux pas de chez vous, je propose une approche centrée sur l’écoute, le respect et le soin apporté à chaque détail. Nous préparons ensemble une séance qui vous ressemble, sans pression ni artifices. Mon accompagnement vous permet de vivre cette étape avec clarté et confiance, dans un cadre pensé pour vous soutenir pleinement.
Vous êtes enceinte et vous habitez à Champagne-au-Mont-d’Or ? Mon studio, situé à quelques minutes seulement, est un lieu apaisant, baigné de lumière, conçu pour les femmes qui souhaitent vivre cette séance autrement. J’accompagne des femmes au parcours singulier, avec une attention portée à ce qu’elles ressentent, à ce dont elles ont besoin. Chaque étape est anticipée, ajustée et pensée pour vous permettre de vivre une expérience fluide, respectueuse et juste.
Vous vivez à Dardilly, et cette grossesse mérite, à vos yeux, plus qu’un simple shooting photo. Mon studio vous accueille pour une séance sur-mesure, construite autour de ce que vous êtes en train de vivre. Dès le premier contact, je vous propose un cadre clair, rassurant, dans lequel chaque décision se prend ensemble. Mon accompagnement repose sur une écoute sincère, un rythme adapté, et un soin porté à chaque détail pour que cette séance prenne tout son sens.
Vous avez parcouru les photos, peut-être lu quelques passages…
Si mon univers vous parle, cette page vous expliquera concrètement comment je travaille, et comment je peux vous accompagner dans ce moment particulier.